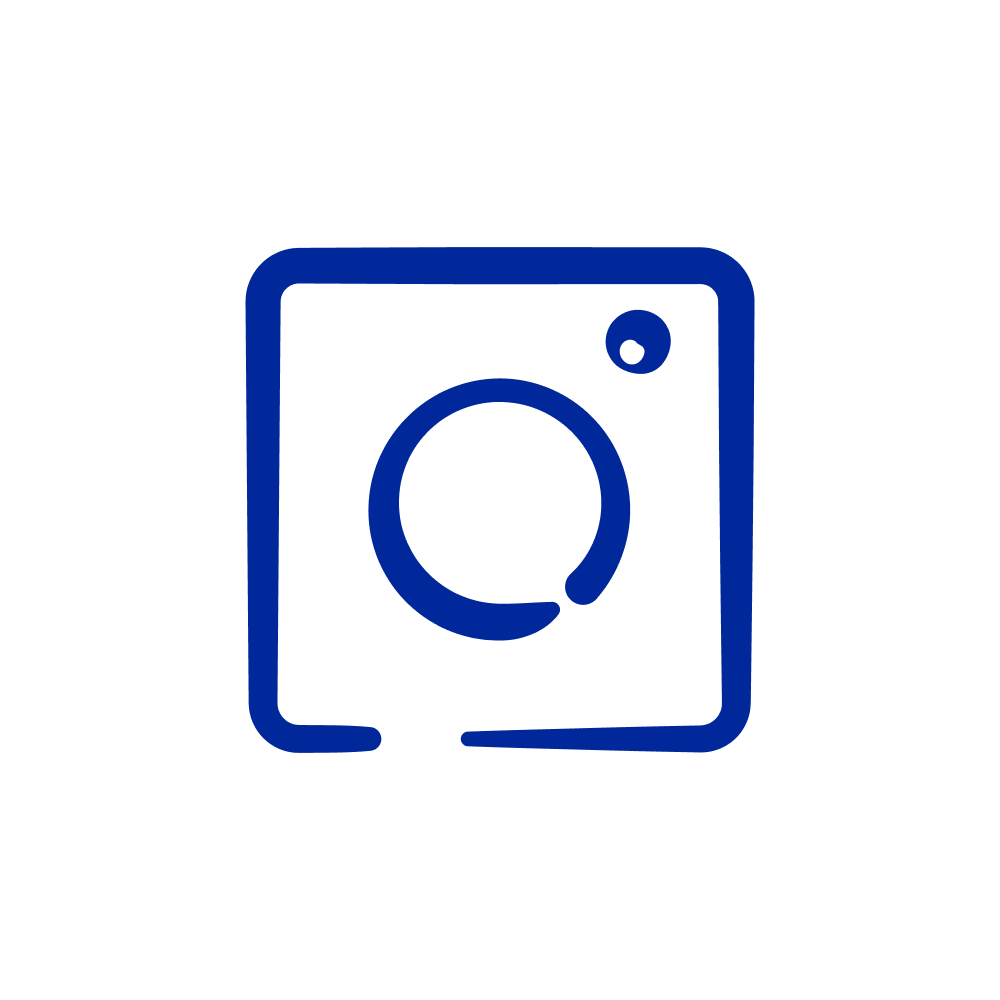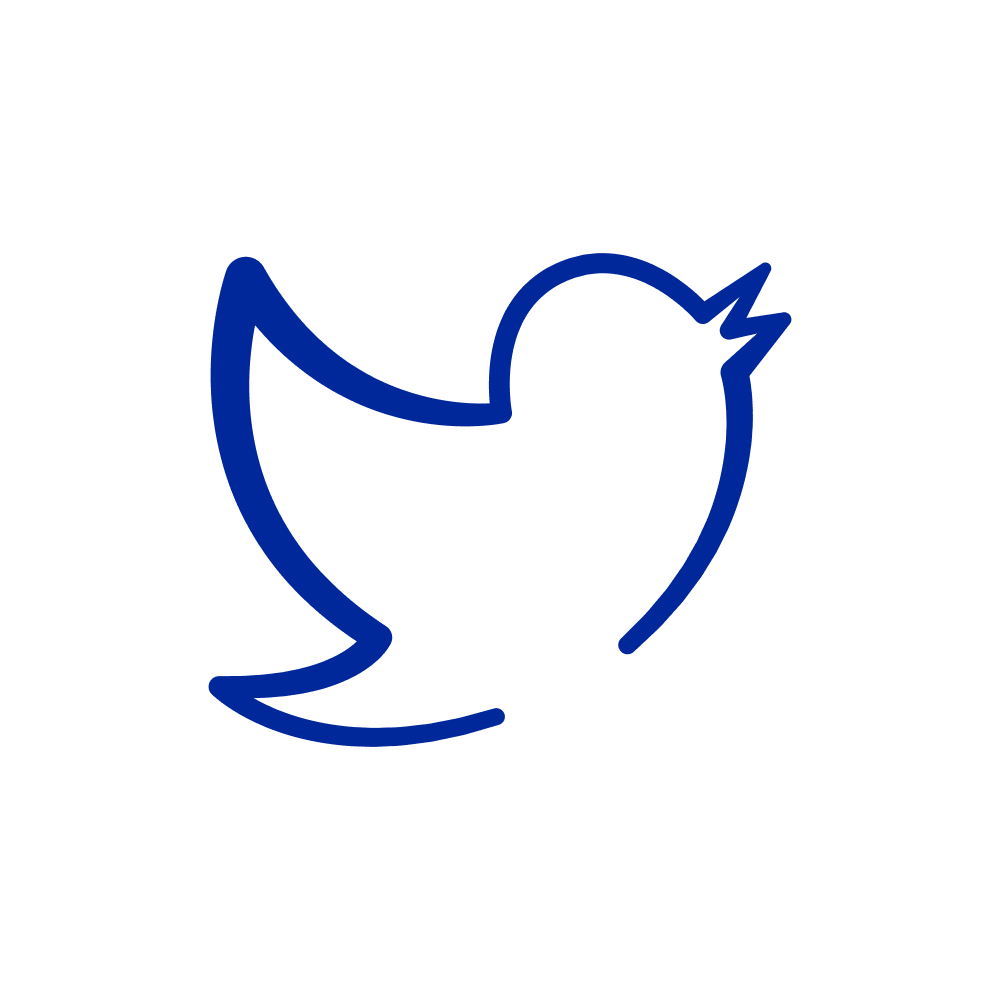Lien
Aux côtés des athlètes
La FDJ Sport Factory

Le soutien aux athlètes de haut-niveau, un engagement historique
Parmi nos engagements pour le sport français, nous avons créé en 1991 le programme Challenge. En 28 ans, celui-ci a accompagné plus de 400 athlètes, jeunes espoirs du sport français, valides ou en situation de handicap en les aidant à se révéler et à construire dans des conditions optimales leur carrière sportive. Ils ont remporté 162 médailles olympiques et paralympiques. Au Challenge a succédé en 2020 la FDJ Sport Factory.
Entre 2020 et 2024, FDJ a ainsi accompagné 52 athlètes athlètes dans leur préparation olympique et paralympique, qui ont remporté 43 médailles.
Rendez-vous bientôt pour découvrir les athlètes qui seront soutenus à partir de 2025 !
Qu’est-ce que la FDJ Sport Factory ?
La FDJ Sport Factory, c’est un accompagnement ambitieux et inscrit dans la durée, offert aux athlètes pour leur permettre de préparer plus sereinement leurs grandes échéances sportives et également leur reconversion après la fin de carrière. En plus de l’aide financière, les athlètes de la FDJ Sport Factory bénéficient d’un programme de formations pour préparer l’après carrière en lien avec de grandes écoles (Sciences Po Paris et l’EM Lyon). Ils disposent également d’un accès complet au programme Sport Compétences qui vise à valoriser dans la sphère professionnelle les compétences acquises durant la carrière sportive. Les athlètes de la FDJ Sport Factory ont été sélectionnés par un jury d’experts.
-
52 Champions accompagnés entre 2020 et 2024
-
43 Athlètes de la FDJ Sport Factory médaillés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, Tokyo et Paris
L'actualité de la FDJ Sport FactoryL'actualité de la FDJ Sport FactoryL'actualité de la FDJ Sport FactoryL'actualité de la FDJ Sport FactoryL'actualité de la FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter novembre 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter octobre 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter septembre 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter août 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juillet 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juin 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mai 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter avril 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mars 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter février 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter janvier 2024 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter décembre 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter novembre 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter octobre 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter septembre 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juin 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mai 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter avril 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mars 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter février 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter janvier 2023 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter décembre 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter novembre 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter octobre 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter septembre 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juillet 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter avril 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mars 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter février 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter janvier 2022 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter décembre 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter novembre 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter octobre 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter septembre 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter août 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter #2 juillet 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juillet 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juin 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mai 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter avril 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mars 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter février 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter janvier 2021 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter décembre 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter novembre 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter octobre 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter septembre 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter août 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juillet 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter juin 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter mai 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter #2 avril 2020 – FDJ Sport Factory
Lien
Newsletter avril 2020 – FDJ Sport Factory
Lien